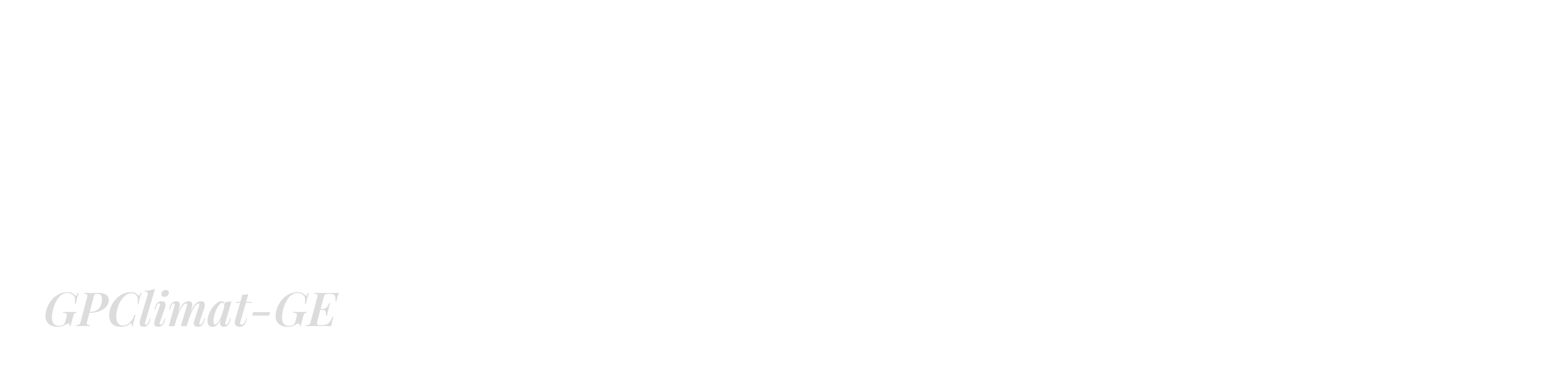Jaclim Lecocq
Comment aller bien dans ce monde qui ne répond pas aux besoins fondamentaux de l’humanité, dont certains Etats dérivent sans retenue vers les excès d’une droite décomplexée et autoritaire. Sans parler des guerres monstrueuses qui ravagent notre planète.
Et pendant ce temps, la 7ème limite planétaire, l’acidification des océans vient d’être dépassée.
Chez nous, la démocratie s’effrite, certains de nos dirigeants revisitent sans scrupule les décisions résultant des votations populaires. Un exemple : bien que refusé dans les urnes en 2017, le nucléaire retrouve ses lettres de noblesse.
Alors, pour sortir de ce marasme qui pèse sur le moral, plongeons-nous dans la lecture d’ouvrages dont les auteurs nous laissent entrevoir des raisons d’espérer.
« Ralentir ou périr », l’économie de la décroissance, tel est le titre sans équivoque du chercheur français en économie écologique, Timothée Parrique.
Sans surprise, l’auteur dénonce le capitalisme, l’hégémonie de l’économique sur tout le reste et la poursuite effrénée de la croissance, celle-ci n’étant pas une fatalité mais un choix. Nous savons que la taille actuelle de l’économie dépasse de loin les limites planétaires. Timothée Parrique définit l’économie comme l’organisation sociale de la satisfaction des besoins. De là, découle que la pauvreté n’est pas le manque d’argent mais l’incapacité de satisfaire un besoin. Ce qui compte, ce n’est pas le pouvoir d’achat mais plutôt le pouvoir de vivre.
Dès sa construction le PIB n’a jamais été un indicateur de bien-être. Il est borgne quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l’état de la planète.
La croissance et la décroissance du PIB ne nous disent pas grand-chose sur la performance véritable d’une économie. Il ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables, celles qui satisfont les besoins réels et celles qui viennent en créer de nouveaux.
Timothée Parrique définit une croissance verte, comme une croissance de la production juxtaposée à une baisse de la charge écologique qui respecterait les limites planétaires. Pour lui, cet idéal n’a jamais existé.
Après l’analyse des travers de la croissance et ses fausses promesses, le concept de la décroissance est abordé. Mais avant de décroître, il faut d’abord décroire, se débarrasser de la religion de la croissance.
La décroissance est vue comme une période de transition vers la post-croissance.
Elle nous oblige à repenser notre rapport au monde, à la nature, à la justice, au sens de la vie, et au bien-être.
C’est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l’empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Ce ralentissement concerne en priorité les pays riches et les plus privilégiés de nos sociétés.
Dans son livre, l’auteur énumère d’une manière très claire et complète les pistes permettant cette nouvelle orientation.
La post-croissance qui devrait suivre est une économie stationnaire qui permet de prospérer sans croissance, en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble et où les richesses sont équitablement partagées.
Un exemple : une taxation progressive des revenus permettrait de financer un revenu minimum garanti, fixé au seuil de pauvreté.
L’idéologie de la croissance doit être remplacée par un autre mode d’existence fondé sut les relations humaines, l’accomplissement intellectuel et spirituel dans une relation épanouie avec le monde qui nous entoure.
La santé, l’éducation, les transports, l’énergie, l’alimentation, le logement, sont des secteurs qui devraient être gérés le plus démocratiquement possible dans la logique coopérative de la non-lucrativité.
Même si cette cure de désintoxication matérialiste s’avère désagréable pour les consommateurs largement aliénés, retarder l’action climatique par peur de déprimer une minorité de super-riches paraît indécent dans un monde où la pauvreté subsiste.
Dans le chapitre 8, l’auteur répond avec beaucoup d’arguments aux 12 critiques habituelles formulées contre la décroissance. S’entêter à vouloir croître sans limites, ce n’est pas du développement, c’est de la boulimie.
En conclusion, la décroissance est une nécessité écologique, mais c’est aussi une aubaine sociale et existentielle. Ralentir pour survivre, mais ralentir surtout pour bien vivre, pour exister vraiment.