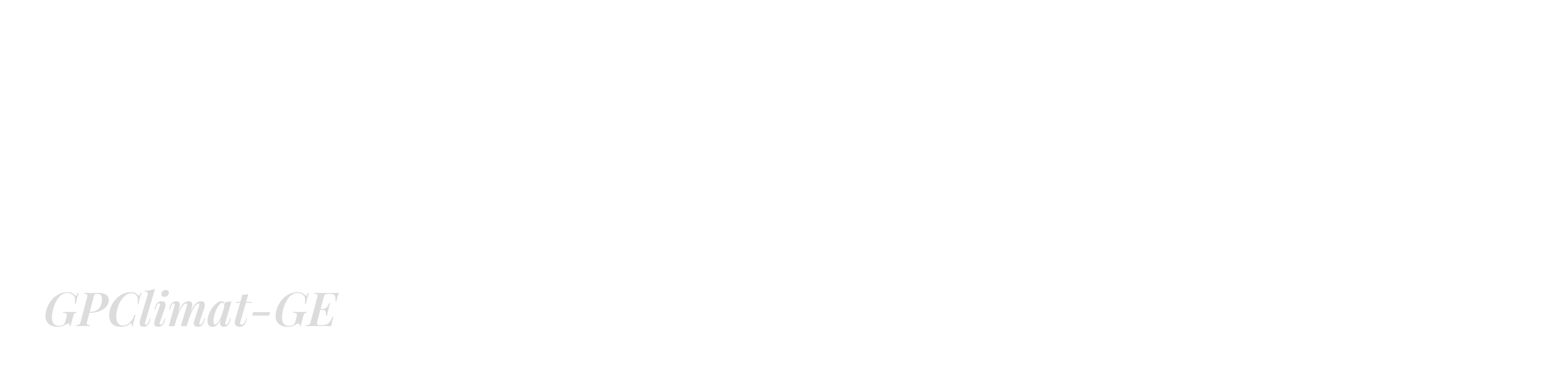Dr Jean Martin
A propos de :
Sevan Pearson, « Le long combat de Aînées pour le climat ». Savoir suisse/PPUR. EPFL, Lausanne, 202, 195 pages.
Chez Savoir suisse paraît le livre de Sevan Pearson, journaliste qui a suivi depuis 2016 la saga des Aînées pour le climat et qui décortique utilement huit années d’efforts, de rebuffades (par de beaux esprits conservateurs et contempteurs de ce qu’ils voyaient comme un activisme féminin hors de propos), de remarquable persévérance et d’argumentaires juridiques étoffés, avec finalement une grande victoire.
Restitution d’une épopée. Les éléments de droit pertinents, notamment liés à la Convention européenne des droits de l’homme, sont rappelés, de même que les points principaux de l’argumentation mise en œuvre par les Aînées et leur équipe juridique aux différentes étapes de cette saga, devant les tribunaux suisses puis la CEDH. On trouve aussi de larges mentions des échos qu’en ont donnés les médias ici et ailleurs, ainsi que des extraits d’entretiens avec les principaux protagonistes. Au final, un parcours substantiel de huit ans, plein d’efforts de sensibilisation et conviction pour les Aînées, de recherche juridique ciblée et sophistiquée pour les avocat-es – à l’évidence un travail gigantesque, polyvalent et multiforme (on se croirait parfois dans un roman à suspense, au meilleur sens du terme).
C’est au sein de Greenpeace, avec le rôle majeur de l’expert climatique Georg Klingler, que l’histoire a commencé. Quand, suite au succès de la cause Urgenda aux Pays-Bas en 2015, cette organisation a cherché de quelle manière, sur quel créneau, on pourrait lancer en Suisse une action juridique avec quelques chances de succès. Au parlement fédéral, les Vert-es se sont montrés très intéressés, notamment Anne Mahrer, conseillère nationale à l’époque, l’avocat Luc Recordon, conseiller aux Etats, et Raphaël Mahaim, député vaudois puis conseiller national. Un cabinet zurichois joue un rôle important, avec Ursula Brunner, avocate chevronnée, et Cordelia Bähr, spécialisée en droit du climat et de l’environnement à qui l’on doit l’avis de droit sur lequel se basera la démarche judiciaire des Aînées et qui l’accompagnera jusqu’à l’audition de 2023 et le succès de 2024.
Après études et recherches, c’est la santé de femmes de plus de 75 ans, qui avaient été touchées de façon disproportionnée par les canicules (notamment celle de 2003) et par les pollutions de l’air notamment, qui est apparu comme le « bon candidat » (aussi parce qu’il s’agit d’un groupe adéquatement défini).
L’Association des Aînées pour la protection du climat voit le jour en mars 2016, avec deux co-présidentes, Rosmarie Wydler-Wälti et Anne Mahrer. Aux côtés de ces deux fondatrices, le livre parle de nombreuses autres personnalités ayant oeuvré activement, à divers titres, dans l’association et ses engagements. Plusieurs deviendront emblématiques dans les années qui suivent.
L’action judiciaire est lancée à fin 2016. Les Aînées demandent que la Confédération agisse selon les principes de prévention et de durabilité, conformément aux droits fondamentaux et à l’Accord de Paris de 2015, en se référant aux travaux du GIEC. Une requête de 150 pages est remise au Conseil fédéral. A la demande associative est jointe celle de quatre requérantes individuelles souffrant de problèmes de santé pertinents: une double stratégie est ainsi mise en œuvre.
Le DETEC, département fédéral concerné (de l’énergie et de l’environnement) répond longuement et négativement en avril 2017, refusant d’entrer en matière. S’ensuit un recours au Tribunal fédéral administratif, qui le rejette dix-huit mois plus tard (fin 2018), puis un recours au Tribunal fédéral lui-même, rejeté en mai 2020. Déception, mais les Aînées et leurs avocat-es voient que cela ouvre la porte d’une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), toutes les voies de droit ayant été épuisées dans le pays. Une décision est prise dans ce sens à mi-2020 (en plein covid). La requête est formellement déposée à Strasbourg le 26 novembre 2020 (incluant entre autres des données sur les morts excédentaires causées par les canicules – un millier lors de celle de 2003).
« Le long combat » poursuit en décrivant en détail les épisodes strasbourgeois. Surchargée, la Cour doit faire un examen préalable, un triage. Premier signe encourageant, la requête est admise en mars 2021 et un traitement prioritaire lui est même accordé. Au plan national malheureusement, un mauvais signal pour le climat est donné par le refus populaire de la loi CO2 le 13 juin suivant.
S’ensuivent des va-et-vient juridiques entre Strasbourg et la Suisse officielle, suivis avec un intérêt croissant par des instances et des pays à l’international – notamment une manifestation de soutien de Michelle Bachelet, commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme. L ‘affaire retient de plus en plus l’attention médiatique.
Décision intermédiaire marquante, la CEDH annonce en avril 2022 que la requête des Aînées sera traitée par sa Grande Chambre et ses dix-sept magistrat-es (ce qui est considéré comme une « exception à la règle » par la Cour elle-même).
Un moment majeur de l’épopée est, le 29 mars 2023, l’audition publique par cette Grande Chambre où, outre l’équipe juridique au complet, une bonne délégation des membres de l’association s’est rendue. Les plaidoiries pour les Aînées sont fortes alors que dans sa réponse le représentant du Gouvernement est remarquablement terne.
Tout cela est bien long mais l’issue s’approche. La CEDH, répondant dans un délai plus court que ce qu’on pouvait craindre, rend son arrêt le 9 avril 2024, donnant raison aux Aînées sur (presque) toute la ligne, suscitant un intérêt très important au plan international. Les dernières sections du livre résument le contenu de l’arrêt, la déferlante médiatique puis les conséquences dudit arrêt (pour les réactions en Suisse, voir l’introduction ci-dessus).
Si des politiciens vexés et des juristes formalistes estiment que la CEDH a outrepassé ses droits, maints experts donnent une tout autre analyse : ils voient dans l’arrêt une sorte de révolution, donnant un nouvel élan à la justice climatique en prenant en compte les droits humains et le rôle protecteur de l’Etat face aux risques naturels et à la pollution. Noter que sans les refus successifs en Suisse, les Aînées n’auraient pu saisir la CEDH et donner à leur démarche cette « stature »/visibilité internationale ! Dernières lignes de l’ouvrage : « En obtenant en grande partie gain de cause à Strasbourg, les Aînées ont écrit une page de l’histoire de la justice climatique. Ce n’est sans doute pas la dernière ».
« Le long combat des Aînées pour le climat » est le récit d’une histoire juridique et sociétale exemplaire et marquante. Fourmillant d’informations, bien structuré, avec une présentation aérée et des encarts utiles, l’ouvrage se lit agréablement – pas de jargon académique ou professionnel. À recommander.